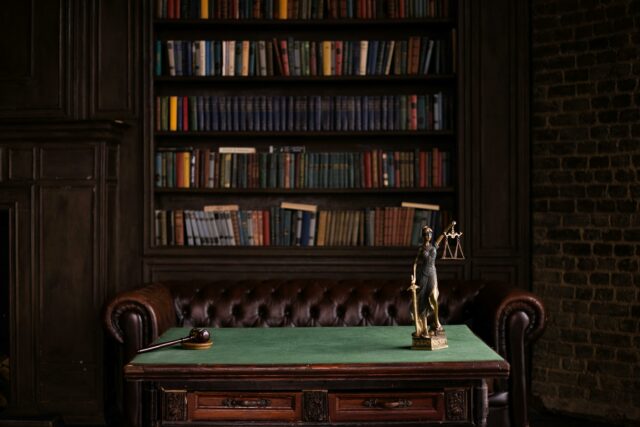« Le Parlement anglais peut tout faire sauf changer un homme en femme ». La célèbre formule que tout étudiant en droit constitutionnel connaît, due au juriste suisse Jean-Louis de Lolme, vient de trouver une illustration dans l’arrêt du 16 avril 2025 de la Cour suprême du Royaume par lequel celle-ci a tranché le différend opposant For Women Scotland Ltd au gouvernement écossais1. L’appel portait sur l’interprétation de la loi sur l’égalité (Equality Act 2010) qui tend à garantir une protection législative aux personnes qui pourraient subir une discrimination illégale. L’affaire au fond tient au sort des femmes et des membres de la communauté transgenre : d’une part, les femmes ont obtenu en 1975 une protection légale contre toute discrimination sur la base du sexe ; d’autre part, la communauté transgenre est considérée comme vulnérable historiquement et encore de nos jours, de sorte que le Parlement a récemment cherché à la protéger légalement. Le débat qui a enflammé la presse – notamment en France – tend à confondre ces deux catégories que la Cour suprême s’est attaché à distinguer nettement.
Avec leur emphase habituelle, les plumitifs et les folliculaires ont évoqué une décision « historique » ou « clivante » voire « dangereuse pour les droits des personnes transgenres », qui bouleverserait les services de ressources humaines, les clubs, les vestiaires, le système de santé… Pourtant, à la lecture du long arrêt de la Cour de 88 pages, la solution est limpide et simple : le droit et la biologie parlent d’une même voix, « un homme est un homme, une femme est une femme » comme l’indique leur sexe biologique. Pour autant, les droits légitimes des personnes trans ne sont pas affectés.
Les faits –
Les faits sont simples, ils mettent en lumière la volonté des femmes écossaises de prévenir des discriminations qui résulteraient de personnes transgenres.
For Women Scotland est une association féministe qui a pour objectif de renforcer les droits des femmes et des enfants en Écosse. L’affaire résulte d’un recours pour excès de pouvoir que l’association a introduit contre la réglementation adoptée sur la base de la loi de 2018 relative à la représentation des genres dans les conseils d’administration publics. Lors d’un premier recours, la requérante avait soutenu que la définition législative du terme « femme » par le texte de 2018 n’entrait pas dans la compétence législative du Parlement écossais. En effet, la loi de 1998 qui attribue à l’Écosse une compétence législative réserve certaines matières au Parlement du Royaume-Uni. Parmi celles-là figure l’égalité des chances (Equal opportunities). Cependant depuis mai 2016, il y a des exceptions à cette matière réservée qui permettent au Parlement écossais de légiférer sur des mesures d’action positive relatives aux personnes à nommer à des postes non exécutifs au sein des conseils d’administration du secteur public. Sur cette base, le Parlement d’Écosse a donc adopté les mesures adéquates en choisissant un critère objectif pour la représentation des genres : 50% des membres non exécutifs sont des femmes. Toutefois, la loi écossaise de 2018 inclut, dans la définition du terme « femme », une personne qui a « la caractéristique protégée d’un changement de genre si cette personne vit comme une femme et se propose de se soumettre, se soumet ou s’est soumise à un processus de transformation dans le dessein de devenir femme ».
C’est cette définition et les dispositions réglementaires qui en sont la conséquence qui ont été contestées par l’association requérante. Celle-ci a gagné en appel devant la juridiction écossaise (Inner Court of the Court of Session) qui a jugé en 2022 que « femme transgenre » n’est pas une caractéristique protégée par la loi de 2010 et que la définition de « femme », adoptée par la loi écossaise de 2018, empiète sur la nature des caractéristiques protégées qui entrent dans le domaine réservé du législateur britannique.
En conséquence, le cabinet écossais (the Scottish Ministers) a adopté un nouveau règlement d’interprétation (statutory guidance), aux termes duquel une personne titulaire d’un certificat de changement de sexe indiquant son genre féminin a le sexe de femme, de sorte que sa nomination serait considérée comme contribuant à remplir l’objectif des 50% de femmes dans les conseils d’administration publique.
Cette solution a été contestée par l’association requérante. Au terme de diverses procédures judiciaires, l’affaire a été portée devant la Cour suprême. Quatre organisations sont intervenues à la procédure. L’association « Sex Matters » a soutenu que la législation en cause devait être interprétée par référence au sexe biologique car les femmes trans, y compris celles disposant d’un certificat de changement de genre, sont déjà protégées par les dispositions relatives au changement de genre et qu’une interprétation élargie du terme « sexe » dans la loi de 2010 conduit à des résultats absurdes ou irrationnels. La Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) a maintenu sa position arrêtée de longue date selon laquelle les termes « sexe » « homme » et « femme » recouvrent ceux dont le sexe a été certifié, tout en reconnaissant que la définition large pouvait donner lieu à des difficultés d’interprétation dans certains domaines notamment la grossesse et la maternité, la protection contre la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle etc… Amnesty International et des associations lesbiennes ont aussi déposé des observations. Il est à noter que ces dernières ont mis l’accent sur les difficultés pratiques créées par la définition large des termes « sexe » et « femme ».
Le raisonnement et la décision de la Cour –
D’emblée, la Cour suprême – qui a succédé au Comité judiciaire de la Chambre des Lords – affirme qu’elle n’a pas pour fonction de légiférer sur le genre ou le sexe, ni de définir le mot « femme » autrement qu’il ne l’est dans la loi relative à l’égalité de 2010 (« the Equality Act 2010 »). Son rôle n’est pas davantage de définir une politique en la matière. Il lui revient seulement de considérer le sens que le Parlement entendait donner aux termes dont il a usé dans la législation relative à la protection des femmes et des membres de la communauté en cause contre toute discrimination. La loi vise à réduire les inégalités et à protéger les personnes contre toute discrimination. Parmi celles-là il y a les femmes dont la caractéristique protégée est le sexe et les personnes transsexuelles dont la caractéristique protégée est le changement de genre.
Tout d’abord, la loi contre la discrimination sur la base du sexe (Sex Discrimination Act) de 1975 interprète les termes homme et femme par renvoi au sexe biologique. Il existait certes une communauté trans à l’époque, mais elle n’était pas légalement reconnue ni protégée. La jurisprudence de la Cour européenne de justice a considéré la directive européenne sur l’égalité de traitement sous l’angle de discrimination alléguée en lien avec la conversion sexuelle d’une personne2. Cela a conduit le législateur anglais, en 1999, à amender la loi de 1975 ; cependant, tout en établissant une protection propre aux personnes qui souhaitent entreprendre ou entreprennent ou ont entrepris un changement de sexe, ces amendements n’ont pas pour autant modifié le sens des mots homme et femme tels que définis par la loi de 1975.
Ensuite, pour donner effet à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Parlement britannique a adopté, en 2004, la loi relative à la reconnaissance du genre (Gender Recognition Act 2004). Dans l’affaire Goodwin v United Kingdom (2002), la Cour européenne avait jugé que l’absence de reconnaissance légale de genre d’un homme qui avait été médicalement transformé en femme constituait une violation du droit à la vie privée, dans la mesure où l’intéressé ne pouvait être considéré comme telle légalement3. Quand un certificat de changement de genre est délivré, le genre de la personne intéressée devient, à toutes fins utiles, le genre acquis.
Enfin, la loi de 2010 (Equality Act 2010) établit un régime de protection pour les personnes qui pourraient être exposées au risque d’une discrimination illégale. Ce texte est au centre du litige puisqu’il s’agissait de déterminer l’effet, s’il y a lieu, de la loi de 2004 sur l’interprétation des termes « sexe », « homme », « femme », « masculin », « féminin ». La question centrale, pour la Cour, était de savoir si la loi de 2010 traite une femme trans titulaire d’un certificat de changement de genre comme une femme à tous égards, ou bien, quand la loi vise une « femme » et le « sexe », si elle renvoie à la femme biologique et au sexe biologique. Or, le contexte dans lequel la loi de 2010 a été adoptée demeure celui de la loi de 1975 qui renvoie la définition de l’homme et de la femme au sexe biologique, les transgenres bénéficiant d’une protection propre au changement de genre. Interpréter le terme sexe comme sexe certifié serait contraire aux définitions des mots « homme » et « femme » tels qu’ils sont compris par la loi de 1975.
Se fondant sur la terminologie de la législation écossaise, la Cour a considéré qu’une personne qui est biologiquement un homme – c’est-à-dire qui à la naissance est de sexe masculin – mais qui a les caractéristiques protégées du changement de genre est décrite comme une « femme trans » (trans woman). De même, une personne qui est biologiquement une femme – car elle a un sexe féminin à la naissance – mais qui a la caractéristique protégée du changement de genre est désignée comme un « homme trans » (trans man). Selon la Cour, les femmes trans et les hommes trans sont ceux qui ont obtenu un certificat de changement de sexe aux termes de la loi de 2004 et leur genre résultant du certificat est leur « genre acquis » ou « sexe acquis ». En conséquence, la Cour use de l’expression « sexe biologique » pour décrire le sexe de la personne à la naissance et l’expression « sexe certifié » pour désigner le sexe obtenu par l’acquisition d’un certificat de changement de sexe.
La Cour suprême rejette la suggestion de la Inner House (chambre d’appel de la Court of Session qui est la juridiction suprême en matière civile en Ecosse) selon laquelle les mots pourraient avoir un sens variable de telle sorte que, dans les dispositions relatives à la grossesse et à la maternité, la loi de 2010 se référerait seulement au sexe biologique tandis qu’ailleurs elle se référerait également au sexe certifié.
Le changement de sexe et le sexe forment des bases distinctes pour ce qui est de la discrimination et de l’inégalité. Par conséquent, la Cour conclut que l’interprétation donnée par la Commission Égalité et droits de l’homme (Equality and Human Rights Commission4) qui est une autorité indépendante et le gouvernement écossais créeraient deux sous-groupes parmi les personnes qui partagent la caractéristique protégée de changement de sexe, ce qui donnerait aux personnes transgenres qui possèdent un certificat de changement de genre plus de droits qu’à celles qui n’en ont pas. Par ailleurs, cette interprétation affaiblirait gravement la protection accordée aux personnes dont l’orientation sexuelle est une caractéristique protégée, par exemple en entravant leur capacité à disposer d’espaces et d’associations réservés aux lesbiennes.
La Cour examine les hypothèses dans lesquelles la mise en œuvre des dispositions législatives suppose une interprétation biologique du terme « sexe ». Cela comprend les réglementations relatives aux espaces séparés et aux services non mixtes (y compris vestiaires, refuges, prisons, services médicaux), aux logements collectifs. De même, la Cour relève l’incohérence et le caractère impraticable de la définition du sexe détachée de la réalité biologique dans diverses situations : les associations non mixtes, la participation équitable des femmes aux activités sportives, les forces armées… Il est remarquable que la Commission sur l’égalité et les droits de l’homme a attiré l’attention du gouvernement britannique sur l’interprétation de la loi de 2010 et, ce faisant, elle a appelé à amender le texte pour des raisons de cohérence et des considérations pratiques.
La Cour suprême conclut que l’interprétation fondée sur le sexe biologique – qu’elle considère comme correcte – ne désavantage pas pour autant les personnes transgenres porteuses ou non d’un certificat de changement de genre. À la lumière de la jurisprudence, ces personnes peuvent se prévaloir des dispositions sur la discrimination directe ou indirecte et le harcèlement, sans qu’un certificat ce changement de sexe soit nécessaire ou même utile.
Ces considérations ont conduit la Cour à retenir que les termes sexe, homme et femme au sens de la loi de 2010 doivent être définis et compris par référence au sexe biologique et à conclure à l’invalidité des règles écossaises disputées. Pour autant, le vice-président de la Cour Lord Hodge qui a rédigé l’arrêt avec Lady Rose and Lady Simler, les deux autres membres de la Cour – dont le président Lord Reed – se ralliant à leur opinion, a sagement indiqué qu’il ne convenait pas de lire cette décision comme le triomphe d’un ou plusieurs groupes de la société au détriment d’un autre.
Pour autant, deux observations doivent être formulées sur le fond et sous l’angle institutionnel.
Sur le fond, la Cour suprême adopte une solution réaliste et simple ne cédant pas au dogmatisme qui sévit parfois en la matière. Ainsi, en ce qui concerne le droit à l’identité sexuelle, le juge européen a pu estimer que la condition d’irréversibilité de la transformation de l’apparence de l’intéressé s’analyse en un manquement par l’État défendeur à son obligation positive de garantir le droit au respect de la vie privée. Avec le présent jugement, c’est le sexe biologique qui prévaut sur le prétendu genre.
Sous l’angle institutionnel, l’affaire met en lumière les difficultés créées par la « dévolution » qui a dépecé le pouvoir législatif du Parlement de Londres au profit de parlements locaux, notamment en Ecosse (Scottish Parliament), au Pays de Galles (Senedd Cymru) et en Irlande du nord (Northern Ireland Assembly). L’État demeure en principe un État unitaire mais la dévolution l’a ébranlé, elle crée des tensions et devient un nid à procédures, au moment même où le Royaume Uni affronte les effets du Brexit, la poussée de l’immigration et l’évolution de la monarchie… Par ailleurs, cette affaire montre comment la jurisprudence européenne des cours de Luxembourg et de Strasbourg a pu modifier les notions fondamentales et le système de la Common law.
À cet égard, elle dénote en même temps la place grandissante faite au juge – qu’il soit extérieur (CEDH) ou interne. Certes, le mode de recrutement des magistrats au Royaume Uni évite les dérives du recrutement judiciaire en Europe continentale. L’appel à des professionnels du droit hautement expérimentés par la pratique, en particulier les QC ou KC du barreau londonien, garantit encore la solidité du raisonnement et l’équilibre des solutions judiciaires. Il serait souhaitable qu’il en fût de même sur le continent…
Jean-Yves de Cara Professeur émérite à la Faculté de droit
Avocat au barreau de Paris
Institut Méditerranéen de Droit et de Géopolitique
6
1 The Supreme Court, For Women Scotland Ltd v The Scittish Ministers, (2025) UKSC 16.
2 CJCE, P. v. S. and Cornwall County Council, C-13/94, Recueil, 1996 I-2159.
3 La difficulté avait surgi dans le cadre judiciaire devant la Chambre des Lords dans l’affaire Bellinger v Bellinger (2003) UKHL 21, (2003) 2 AC 467.
4 Organisme public non ministériel en Grande Bretagne qui a la responsabilité de promouvoir et de faire respecter les lois relatives à l’égalité et la non-discrimination en Angleterre, Écosse et Pays de Galles.