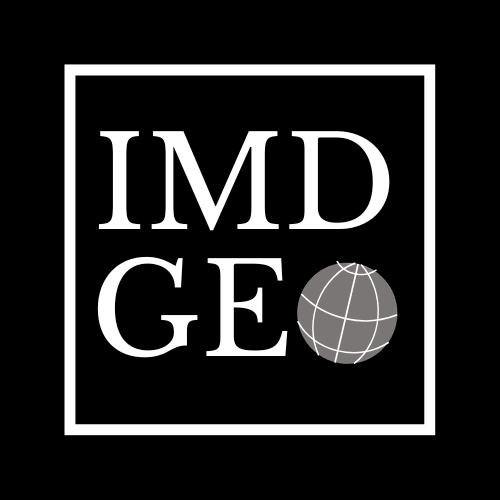Le Cachemire n’est plus « la vallée des rêves » chantée par Kipling. Il est une terre de conflits dont la nouvelle tension qui oppose l’Inde au Pakistan illustre l’âpreté.
En quelques jours le Cachemire s’est embrasé.
Dans la nuit du 6 au 7 mai, les forces indiennes et pakistanaises se sont mutuellement bombardées. Vingt-quatre frappes indiennes de missiles en six endroits au Pakistan, auxquelles ont répondu des tirs d’artillerie dans plusieurs secteurs du Cachemire indien et, selon le Pakistan, plusieurs avions ennemis auraient été abattus. « Le Pakistan se réserve le droit absolu de répondre de façon décisive à cette attaque non provoquée » a déclaré le Premier ministre, Shahbaz Sharif, et la diplomatie pakistanaise a renchéri pour dénoncer l’utilisation par le gouvernement indien de « l’excuse du terrorisme pour mettre en danger la, paix et la sécurité de la région… l’action irresponsable de l’Inde rapproche les deux États nucléaires d’un conflit majeur ».
Le 22 avril 2025, une fusillade avait tué vingt-six hommes dont un ressortissant Népalais à Pahalgam situé dans la vallée de Baisaran, destination touristique à une centaine de kilomètres de la capitale d’été, Srinagar, la capitale d’hiver étant Jammu. Cette attaque par cinq hommes armés de fusils d’assaut – la plus meurtrière en vingt-cinq ans – a été revendiquée par le groupe de la Résistance du Cachemire qui affirme que les victimes étaient des agents des services de sécurité indiens. Les auteurs dénoncent aussi le projet de colonisation démographique mis en œuvre par le gouvernement de Delhi. L’armée indienne a entrepris de pourchasser les membres du commando, affirmant que deux d’entre eux avaient été abattus ; elle a laissé entendre que les assaillants avaient « tenté une infiltration » dans le district de Baramulla à une centaine de kilomètres au nord-est. Le Premier ministre indien entend riposter contre le Pakistan, suspect d’avoir agi en sous-main, sans préciser la nature des représailles. « L’Inde identifiera, poursuivra, punira les terroristes et ceux qui les soutiennent. Nous les traquerons jusqu’au bout du monde. Ceux qui ont mené cette attaque et ceux qui l’ont préparée en paieront le prix au-delà de ce qu’ils imaginent » a déclaré Narendra Modi. D’ores et déjà, des sanctions ont été prises contre la Pakistan : elles sont d’ordre diplomatique et consistent en la suspension de la délivrance des visas, le rappel ou l’expulsion de diplomates, la fermeture de postes-frontières. Le Pakistan a aussitôt pris des mesures similaires.
Surtout, le gouvernement indien a décidé de suspendre le traité de 1960 relatif au partage des eaux de l’Indus conclu entre les deux États sous l’égide de la Banque mondiale ; or cet accord est essentiel pour l’État voisin car il régit le débit de l’eau que l’Inde, en amont du fleuve, laisse couler pour irriguer le Penjab et le Sindh, régions essentielles à l’économie du Pakistan. Ce dernier considère que toute restriction de l’approvisionnement en eau du fleuve partagé serait considérée comme un « acte de guerre ». Lors des précédentes tensions, le gouvernement indien n’avait pas eu recours à une telle mesure, se bornant à de brèves incursions terrestres ou aériennes pour détruire des postes avancés de djihadistes. Le 6 mai, l’Inde a réduit les approvisionnements en eau vers le Pendjab pakistanais.
Le Pakistan nie tout engagement, complicité ou soutien dans les attentats ou les incursions de groupes armés au-delà de la ligne de démarcation qui traverse le Cachemire. Toutefois, il met en garde l’Inde et affirme que « cette nation de 240 millions d’habitants est unie et derrière ses courageuses forces armées prêtes à protéger chaque centimètre carré de sa patrie », menaçant de répondre très fermement à « toute tentative indienne de couper ou de limiter son approvisionnement en eau du fleuve partagé ».
Dès l’attentat du 22 avril, on pouvait craindre une riposte militaire de l’Inde qui a déployé son nouveau porte-avions INS Vikrant et son escorte en haute mer : le groupe aéro-naval a quitté la base de Kadamba au sud de Goa en direction de la mer d’Arabie à quelques centaines de kilomètres des côtes pakistanaises enclavées au nord de la zone maritime qui s’étend à l’est de l’Inde et à l’ouest de la péninsule arabique. Certes, ce navire – dernier fleuron de la flotte indienne, fabriqué en Inde qui s’ajoute aux navires et avions de chasse livrés par la Russie – est une menace conventionnelle puisque ses chasseurs n’emportent pas d’armes nucléaires qui sont réservées par l’Inde aux missiles intercontinentaux terrestres et aux missiles balistiques des sous-marins lanceurs d’engins. Néanmoins, la menace est réelle. L’ONU exhorte donc les parties à la « retenue maximale », les exhorte à ne pas détériorer la situation et appelle à une résolution pacifique de la crise. Les puissances s’inquiètent, l’Iran offre ses bons offices mais le Président Trump juge que les deux parties « vont régler le problème d’une manière ou d’une autre » car « ce conflit existe depuis un millénaire »…
Ainsi, le nouvel attentat d’avril et la riposte du 6 mai marquent un degré supplémentaire dans l’escalade qui met aux prises les deux puissances nucléaires de la région et dont l’issue est imprévisible tant est ancrée l’inimitié entre les communautés nationales.
Les racines de ce conflit sont profondes. Elles remontent à la fin de la 2e guerre mondiale. L’inimitié entre les deux Etats a donné lieu à de multiples incidents et provoqué trois guerres.
Les racines du conflit
Principauté située aux confins de l’Inde, du Pakistan et de la Chine, le Cachemire était, au temps du Raj (administration britannique), dirigé par le maharadja Hari Singh au moment de la partition du sous-continent en 1947 entre le Pakistan et l’Inde. Le paradoxe était manifeste puisque ce royaume majoritairement musulman était gouverné par un prince hindou. Celui-ci n’entendait se rallier à aucun des deux protagonistes, espérant constituer un royaume indépendant. Le massacre de réfugiés musulmans entraîna l’intervention spontanée de tribus du Pakistan complaisant. Le Prince fit appel à Lord Mountbatten, vice-roi et gouverneur général des Indes. L’aide indienne ne fut accordée qu’en échange de l’accession du Cachemire à l’Union indienne. Le Pakistan réagit en envoyant des troupes. Ainsi éclata la première guerre entre les deux jeunes États, à laquelle de façon laborieuse l’ONU mit un terme en imposant un cessez-le-feu dans l’État de Jammu-et-Cachemire par l’accord du 27 juillet 1949 qui fixe une ligne de cessez-le-feu entre les parties.
Cet accord ne doit pas être confondu avec l’accord de Karachi entre le Pakistan et l’Azad Kashmir (région occidentale du Cachemire) signé le 28 avril 1949 – tenu secret jusqu’à 1965 – qui reconnaît au premier le contrôle administratif sur la partie ouest (Gilgit-Baltistan ou provinces du nord) et des pouvoirs en matière de défense d’affaires étrangères et de communication dans cette zone.
La ligne de cessez-le-feu puis de démarcation (dite « ligne de contrôle »), garantie par un groupe d’observateurs militaires des Nations-Unies1, sépare les deux parties du Cachemire sur une longueur de 740 km, le point ultime au nord-ouest n’étant pas fixé sur la frontière avec la Chine, la ligne étant alors définie comme allant « de là vers le nord jusqu’aux glaciers » ; en effet, il s’agit d’une zone montagneuse de haute altitude entre 5000 et 7 000 mètres, occupée en partie par le glacier de Siachen dans le massif du Karakoram. Le long de la ligne, les accrochages sont fréquents, entretenant une forme de guérilla entre les deux États.
Par conséquent, tout en revendiquant l’ensemble du Cachemire, l’Inde exerce une souveraineté effective sur 100 942 km2 (Jammu et Cachemire). La zone pakistanaise représente 78 114 km2 ; elle est divisée en deux régions : le Gilgit Baltistan et le Azad Kashmir. Encore faut-il ajouter que 38 000km2 sont sous l’autorité de la Chine populaire, alliée du Pakistan qui lui a cédé en outre, par l’accord frontalier provisoire du 2 mars 1963, 5180 km2 dans la vallée du Shaksgam (soit au total 43 180 km2 sous contrôle chinois). La population du Cachemire est d’un peu moins de 8 millions d’habitants.
Au cœur des relations conflictuelles entre le Pakistan et l’Inde, les revendications des deux parties sont simples : pour le premier, le Cachemire, à majorité musulmane, aurait dû être rattaché au Pakistan ; pour l’Inde, le Cachemire, principauté indienne, et le Ladakh font partie de l’Union indienne née de la fin de l’Empire britannique.
La situation est complexe. Elle n’est pas étrangère à des considérations psychologiques, religieuses et à deux visions opposées de la nation. Il suffit de rappeler aussi que si la revendication du Pakistan sur le Cachemire se fondait sur l’existence d’une majorité musulmane dans la province, le premier ministre indien le Pandit Nehru, issu d’une lignée de brahmanes hindous et figure de proue du nationalisme indien, était lui-même originaire du Cachemire qu’il souhaitait garder sous la souveraineté indienne. Par ailleurs, il existe alors en Inde des États princiers dont la majorité est hindoue mais dont le prince est musulman et qui ont été intégrés dans l’union indienne : tel était le cas d’Hyderabad (au centre du sous-continent) qui aurait souhaité son indépendance et du Junagadh qui aurait souhaité son rattachement au Pakistan. Cela met en lumière deux conceptions de l’État nation : alors que l’Inde s’est voulue une république laïque et diverse, le Pakistan repose sur l’aspiration des musulmans du sous-continent à se regrouper dans un État dont l’identité nationale est fondée sur l’islam. Un accommodement de ces deux approches semble alors difficile.
Les trois guerres
Il n’y a pas lieu ici de revenir sur les efforts des Nations Unies en 1947-1949 pour trouver une solution. Toutefois, les termes du différend persistant et les thèses des parties formulées alors n’ont guère varié par la suite. C’est l’Inde qui a évoqué la question du Cachemire à l’ONU en portant plainte devant le Conseil de sécurité, le 1er janvier 1948. Elle accusait le Pakistan de soutenir les tribus qui envahissaient le Cachemire, demandant au Conseil de faire cesser cet appui considéré comme une agression contre l’Inde puisque, depuis le 27 octobre 1947, le Cachemire faisait partie de l’Union Indienne.
Le Pakistan objectait en invoquant le non-respect par l’Inde des règles de la partition et en dénonçant cette accession du Cachemire à l’Inde « par la fraude et la violence », évoquant aussi les massacres de musulmans. Habilement, le représentant du Pakistan, le diplomate et juriste Sir Muhammad Zafarullah Khan qui sera plus tard Président de la Cour internationale de justice, après avoir présidé l’Assemblée générale de l’ONU, obtint que la « Question du Jammu et du Cachemire » fût transformée en « Question de l’Inde et du Pakistan », ce qui élargissait l’objet du débat. Il demanda aussi l’établissement d’une administration provisoire impartiale, le retrait de toutes les forces armées et l’organisation d’un plébiscite par l’ONU. Le représentant de l’Inde a accepté trop rapidement – et de façon répétée – la tenue d’un plébiscite comme ultime moyen de régler le statut de la région, même si, à ses yeux, il devait être organisé par le gouvernement Cachemire : cela laissait planer un doute sur la légalité de l’accession de cette région à l’Union indienne et marginalisait l’origine du différend qui tenait à l’invasion des tribus appuyée par le Pakistan. Ces événements primitifs et les premières discussions à l’ONU donnent la mesure des difficultés récurrentes de la région depuis près de soixante-dix ans.
De nombreuses médiations ont été vainement tentées depuis la mission officieuse du général canadien McNaughton, suivie de la médiation dont le Conseil de sécurité chargea Sir Owen Dixon puis le Dr Frank Graham en 1950, jusqu’à la mission Jaring en 1957 ; cela reflète l’impasse dans laquelle se trouvait l’organisation mondiale pendant la guerre froide, l’Union soviétique craignant de ne pouvoir exercer son droit de veto puisque la résolution Acheson du 3 septembre 1950 a donné à l’Assemblée générale où les Occidentaux disposent d’une large majorité, compétence pour le maintien de la paix en cas de blocage du Conseil de sécurité. De plus, une certaine proximité du Pakistan avec les Etats-Unis équilibrait l’inclination de l’Inde pour la Russie. Cette dernière usa habilement du droit de veto sur certaines résolutions, s’abstenant sur d’autres, telle le texte qui chargeait M. Jarring d’approcher les deux gouvernements pour aboutir à un règlement dans l’esprit des résolutions du Conseil de sécurité. Le blocage résultait des positions respectives des deux parties sur le plébiscite, sur un arbitrage éventuel, sur le principe d’une administration internationale provisoire, solutions que le Pakistan pouvait prendre en considération mais dont l’Inde n’acceptait pas le principe puisqu’elle considérait que l’ensemble du territoire lui appartenait et que l’arbitrage, un plébiscite ou toute autre procédure constituerait une ingérence dans ses affaires intérieures. Sans doute, la signature du traité sur les eaux de l’Indus donna l’impression d’un apaisement mais toute tentative, même de négociation, dès lors qu’elle portait sur le statut du territoire, était vouée à l’échec. Dans ces circonstances, la Russie suggérait une négociation directe entre les parties auxquelles il revenait de décider si elles souhaitaient recourir à une instance internationale. Rien n’y fit.
Une deuxième guerre éclate en août 1965. Le refus de l’Inde d’organiser la consultation de la population prévue en 1948 incite le Pakistan à susciter une insurrection au Cachemire indien. Le secrétaire général de l’ONU, U’Thant, tenta une médiation en raison de la situation « grave et dangereuse pour la paix » puis il saisit le Conseil de sécurité. Les appels au cessez-le-feu et la mission de paix confiée au secrétaire général furent vains ; le renforcement du groupe d’observateurs militaires de l’ONU sur la ligne de démarcation fut insuffisant : une quarantaine sur plus de 700 kilomètres. Le péril d’un affrontement direct s’accroît en septembre : les deux parties s’accusent de provoquer des incidents le long de la ligne. Le Pakistan annonce « la création d’un conseil révolutionnaire par le peuple du Cachemire pour mener la guerre de libération contre l’impérialisme indien ». Les troupes indiennes franchissent la ligne de cessez-le-feu en se justifiant par la nécessité d’empêcher de nouvelles infiltrations pakistanaises et de contrôler les routes de repli des éléments qui se sont déjà infiltrés en territoire indien. Les troupes indiennes se rapprochent de Lahore, capitale du Penjab pakistanais. Les forces pakistanaises lancent des raids sur le Rajasthan, la tension internationale monte quand la Chine menace d’intervenir, se heurtant aux menaces américaines de contre-intervention. On ne se faisait guère d’illusion sur la « mission de paix » du secrétaire général de l’ONU. Lorsque ce dernier suggéra le recours aux mesures coercitives prévues par la Charte, il se heurta au refus catégorique de l’Union soviétique suivie avec des nuances par la France. Ce fut donc une rédaction énergique qui fut adoptée par le Conseil de sécurité qui demandait le cessez-le-feu et le retrait des troupes en vue de l’examen du problème politique, mais cette résolution du 20 septembre n’évoquait plus le plébiscite. Les deux parties acceptèrent de se plier à la volonté du Conseil de sécurité, bien que le Pakistan fût très critique et menaçât de quitter l’organisation mondiale si la question du Cachemire n’était pas réglée au fond. Après l’intervention du cessez-le-feu, une nouvelle mission d’observateurs était créée pour surveiller la ligne et s’assurer du retrait des troupes sur leurs positions antérieures (U.N.I.P.O.M.). Néanmoins l’affaire est réglée, provisoirement, par des négociations directes entre les parties, menées hors de l’ONU, à l’initiative du gouvernement de l’Union soviétique de M. Alexis Kossyguine : la déclaration de Tachkent du 10 janvier 1966, signée par le ministre indien Lal Bahadur Shastri et le président pakistanais Mohammed Ayoub Khan, prévoit le retrait des forces des deux États sur les positions qu’elles occupaient avant le 5 août. En conséquence, l’UNIPOM est dissoute et les effectifs de UNMOGIP sont réduits.
Une guerre larvée se poursuit. En décembre 1971, c’est une guerre ouverte. Elle n’a pas pour champ le Cachemire maiselle est ultime développement de la partition de l’Inde. Celle-ci, dirigée par Indira Ghandi, prend parti pour le Pakistan oriental en massant des forces le long de la frontière du Cachemire dans l’attente d’une attaque préventive du Pakistan, pour riposter sans que soit en cause le territoire du Cachemire. L’attaque de l’aviation pakistanaise sur plusieurs bases indiennes permet à l’armée indienne de répliquer par une offensive éclair sur le Pakistan oriental dont les rebelles recevaient déjà le soutien indien. Une force militaire indienne de 160 000 hommes entre au Pakistan oriental et écrase l’armée pakistanaise de 73 000 hommes, isolée, assiégée dans Dacca, tandis que la marine pakistanaise est neutralisée par deux opérations navales indiennes contre le port de Karachi. La défaite est acceptée par le président Yahya Khan qui démissionne après le cessez-le-feu. Le Pakistan oriental gagne son indépendance et prend le nom de Bangladesh. Le conflit régional reflète les tensions entre les deux États rivaux du sous-continent mais aussi la guerre froide car, alors que les Etats-Unis soutiennent le Pakistan, l’Inde a signé un traité d’amitié, de paix et de coopération avec l’URSS, le 9 août 1971, perçu comme une véritable alliance dans la mesure où il comporte un engagement mutuel en matière de sécurité et de défense. Même si le Cachemire n’est pas un théâtre d’opérations, la contre-offensive éclair de l’Inde sur le Pakistan qui avait attaqué plusieurs bases aériennes indiennes de façon préventive, aboutit à la défaite de l’armée pakistanaise quelques jours plus tard. Il est vrai que l’envoi d’un porte-avion américain dans le golfe du Bengale favorise le cessez-le-feu mais aussi prévient une annexion du Cachemire par l’Inde qui aurait pu entraîner l’effondrement du Pakistan.
Une troisième fois, les deux États rivaux s’opposent directement sur le Cachemire. Cette « guerre des glaciers » en 1999, naît des infiltrations des forces pakistanaises à travers la ligne de contrôle sur les hauteurs de Kargil pour s’emparer de la route stratégique Srinagar-Leh. L’affrontement, bref, se déroule en terrain de montagne du 3 mai au 26 juillet ; il connaît un retentissement mondial car cette guerre conventionnelle oppose deux puissances nucléaires, le Pakistan ayant franchi le seuil nucléaire à l’occasion de cinq essais un an plus tôt. La situation dénote aussi une certaine duplicité du Premier ministre du Pakistan, Nawaz Sharif : quelques semaines plus tôt, il avait accueilli le premier ministre indien Atal Bihari Vajpayee et signé avec lui la déclaration de Lahore par laquelle les deux États s’engageaient à normaliser leurs relations et à limiter la course aux armements nucléaires. La réaction indienne est vigoureuse pour déloger les intrus des 130 postes occupés en haute altitude. Le gouvernement indien cherche aussi à obtenir des Etats-Unis des garanties de sécurité. Celles-ci sont alors accordées à condition que le gouvernement d’Islamabad accepte le retrait immédiat de ses troupes des positions occupées. Ce retrait obtenu, l’armée indienne regagne ses postes en montagne et l’Inde recouvre le contrôle complet sur le Cachemire indien.
L’histoire de ces affrontements vérifie la « périodicité des guerres » évoquée par Gaston Bouthoul. Elle illustre aussi le phénomène contemporain des guerres endémiques et constantes qui fragilisent l’ensemble de la société internationale. Au point de départ, elles n’avaient rien à voir avec la préférence de chacun des États successeurs du Raj britannique à l’échelon planétaire ni avec l’action soviétique ou américaine2. Désormais, elles reflètent l’équilibre de la terreur dans le sous-continent indien à proximité d’une puissance nucléaire, la Chine, et d’autres États « du seuil nucléaire ».
La paix semble impossible mais la guerre est-elle improbable3 ?
Les événements récents font écho aux affrontements récurrents entre les deux États. Or, depuis 2000 les incidents se sont accumulés ; ils révèlent un changement de tactique du côté pakistanais, substituant de multiples attentats dans la région indienne du Cachemire aux accrochages directs : massacre de Sikhs à Chittisinghpura par des hommes en uniforme en 2000 ; attentat contre la base militaire de Kaluchak en 2002 ; multiples attaques coordonnées à Bombay du 26 au 29 novembre 2008 par des terroristes du groupe salafo-jihadiste Lashkar-e-Taiba, venus du Pakistan par la mer et faisant 174 morts et plus de 300 blessés parmi les citoyens indiens et les touristes ; attaque mortelle d’un bus de pèlerins hindous rentrant du pèlerinage d’Amarnath en 2017 ; attentat suicide au véhicule piégé du groupe terroriste Jaish-e-Mohamed contre un convoi militaire, tuant au moins quarante soldats à Pulwama en février 2019, donnant lieu à des représailles aériennes indiennes sur Balakot au Pakistan ; huit morts dans des affrontements entre rebelles et forces de sécurité dans des villages du district de Kulgam en juillet 2024….
De son côté, en 2017, le ministre des affaires étrangères pakistanais dénonçait les atrocités commises par l’Inde au Cachemire dénonçant un « génocide ». En effet, des heurts entre manifestants et forces de sécurité ont éclaté en juillet 2016 lorsqu’un leader séparatiste du Cachemire, Burhan Wani, a été tué par les forces indiennes. Selon la presse internationale, depuis cette date, les violences auraient fait une centaine de morts et plus de 9000 blessés. En 2023, l’ancien secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, affirmait que les deux États étaient près de basculer dans un affrontement nucléaire dont les Etats-Unis avaient évité l’escalade en février 2019 lors des frappes aériennes indiennes en territoire pakistanais en représailles contre l’attentat suicide contre les paramilitaires indiens ; le Pakistan avait riposté en abattant un avion et en capturant le pilote4. Les diplomates auraient alors convaincu les parties qu’aucune des deux ne se préparait à une attaque nucléaire.
En août 2019, le gouvernement de Nagendra Modi a décidé de franchir une étape institutionnelle définitive en mettant un terme au statut spécial de l’État du Jammu-et-Cachemire, prévu par l’article 370 de la Constitution qui lui accordait une semi-autonomie. En effet, selon cette disposition était reconnu au Maharaja jusqu’en 1952, année d’abolition de la monarchie, puis au président de l’État (Sadr-e-Riyasat) élu par l’assemblée législative locale, le pouvoir de légiférer avec l’assemblée locale, sauf dans certains domaines sensibles tels que la défense, les affaires étrangères ou les finances ; les lois votées par le Parlement fédéral devaient être soumises à l’assemblée du Jammu-et-Cachemire. En outre, selon l’article 35-A, également abrogé, les résidents permanents de la région – nés au Cachemire ou y résidant depuis depuis plus de dix ans et y ayant légalement acquis un bien immobilier – jouissaient d’une citoyenneté séparée et ils étaient autorisés à acheter des biens immobiliers dans l’Union alors que les citoyens des autres États ne pouvaient en acquérir au Jammu-et-Cachemire. Ce dernier point constituait une restriction aux investissements indiens dans la vallée au Jammu-et-Cachemire ou au Ladakh, ce qui était de nature à freiner le développement. Il importe d’ajouter que dès l’origine ces dispositions étaient un « arrangement provisoire, de transition et non un élément permanent de la Constitution » comme cela a été confirmé par Nehru en novembre 1963 à l’Assemblée nationale, ces dispositions devant disparaître. Désormais, cet État au régime spécial a été réorganisé en deux territoires de l’Union et dépourvu de ses privilèges législatifs ; la région de Jammu-et-Cachemire constitue un territoire de l’Union placé sous l’autorité du gouvernement fédéral. Le 11 décembre 2023, la Cour suprême de l’Inde, saisie de 23 requêtes, a confirmé à l’unanimité l’abrogation de l’article 370,, considérant que le Jammu-et-Cachemire s’était dépouillé de « tout élément de souveraineté » après l’exécution de l’instrument d’adhésion à l’Union en octobre 1947. Les privilèges spéciaux du Jammu-et-Cachemire ainsi qu’une constitution distincte ont été considérés comme une simple caractéristique du « fédéralisme asymétrique » et non comme une souveraineté. Il s’agissait en somme d’une formule transitoire destinée à faciliter l’accession d’un État princier à un l’Union indienne en des temps de conflit civil et de guerre.
De nouveau les armes parlent. Mettant ses menaces à exécution, l’Inde a tiré des missiles sur des sites abritant, selon elle, des infrastructures terroristes au Pakistan. Ce dernier a riposté par des tirs d’artillerie visant plusieurs cibles en territoire indien. L’Inde menace de couper les approvisionnements en eau du Pakistan. Plusieurs morts ont été dénombrés du fait des bombardements mutuels de l’Inde et du Pakistan. Les puissances s’inquiètent ; le secrétaire d’État américain a appelé les deux États à « désamorcer la situation et à éviter une nouvelle escalade ». Le secrétaire général de l’ONU appelle les deux États à « la retenue » et offre ses bons offices : « le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire entre deux puissances nucléaires ». Ainsi se poursuit un conflit né d’un règlement diplomatique défectueux qui remonte à soixante-dix ans…
Jean-Yves de Cara
Professeur émérite Sorbonne Paris Cité
Avocat au barreau de Paris
Institut Méditerranéen de Droit et de Géopolitique
1 UNMOGIP, groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et le Pakistan, arrivé dans la zone de mission le 24 janvier 1949 (106 personnes, civils et experts en mission, en février 2025) ; mission confirmée par la résolution 307(1971) du Conseil de sécurité).
2 R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, 1962, 1984.
3 Pour paraphraser la formule de R. Aron au premier chapitre de son livre Le grand schisme, Paris 1948
4 Never Give an Inch : fighting fot the America I love, 2023, Broadside Books.