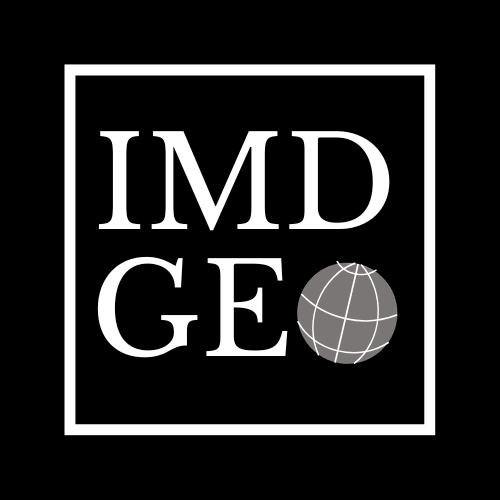Nombreux sont les observateurs qui s’étonnent des déclarations intempestives du Président élu des États-Unis, Donald Trump, relatives au Groenland, au canal de Panama et au Canada. Celles-là ne sont pas le fruit d’un esprit fantasque. Elles soulèvent des interrogations et des spéculations dans les chancelleries quant aux intentions réelles de la nouvelle administration américaine. Des facteurs historiques, géopolitiques et politiques éclairent ces annonces à la veille de l’investiture du Président des États-Unis.
1 – En 2019, au cours de son premier mandat, le Président Trump avait déjà fait connaître son souhait d’acheter le Groenland et il fit étudier par ses conseillers les conditions financières de cette acquisition. Réélu, il réitère sa proposition et, dans un message de Noël à la population du Groenland, il confirme que les États-Unis en ont besoin à des fins de sécurité nationale. L’idée n’est pas nouvelle. Dans la doctrine géopolitique américaine – par un effet lointain de la doctrine Monroe de 1823 – ce territoire de plus de deux millions de km2 entre dans la sphère de sécurité américaine. Ce territoire qui appartient au Danemark depuis le traité de Kiel de 1814 et bénéficie d’un statut d’autonomie depuis 1979, renforcé en 2009, a déjà été revendiqué par les États-Unis dans le passé. Tout d’abord, en 1867, lors de l’achat de l’Alaska à l’Empire russe, le président Andrew Johnson avait adressé au Danemark une proposition financière d’acquisition du Groenland qui s’étendait en outre à l’Islande. L’offre fut rejetée. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, en 1946 le Président Harry Truman avait renouvelé cette proposition américaine pour cent millions de dollars, laquelle fut encore refusée. Outre l’importance de ses ressources naturelles, le territoire présente un intérêt stratégique accentué par la fonte de la calotte glaciaire qui favorise la navigation internationale dans cette région proche de l’Amérique. Depuis 1941, les États-Unis disposent d’une base militaire à Thulé, à 1500 km du pôle Nord, désignée comme la base de Pituffik depuis 2023, sur la côte nord-ouest du Groenland. Elle permettait à l’origine de protéger l’Atlantique nord du danger des sous-marins allemands, mais elle a acquis une importance stratégique accrue pendant la guerre froide. Agrandie, transformée en base de détection des missiles et d’information pour les lancements de satellites et de navettes spatiales (US Space Force), elle constitue un maillon de la chaîne de commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du nord (NORAD).
Le mythe du passage du nord-ouest qui nourrit l’imagination de Chateaubriand et les ambitions de marins aventureux est dépassé par la réalité géostratégique arctique liée au réchauffement climatique. De nouvelles routes commerciales essentielles sont envisageables pour la Chine, la Russie. En octobre 2024, des navires chinois et russes ont été détectés navigant en formation dans la mer de Béring et des bombardiers de ces deux nations ont volé dans l’espace aérien près des côtes de l’Alaska. Des armements chinois se lancent sur la route maritime du nord et des recherches scientifiques chinoises sont envisagées en Arctique. Ces mouvements alimentent l’inquiétude américaine pour des raisons stratégiques et sont liés aux richesses majeures du sol, du sous-sol et de la mer. Or, s’il est vrai qu’au regard de la Charte des Nations Unies, la conquête de territoires par la force est contraire au droit international, l’acquisition pacifique d’un territoire par accord, achat ou cession à bail est licite. D’ores et déjà, un groupe de Républicains a déposé une proposition de loi intitulée « Make Greenland Great Again », en clin d’œil au slogan de la campagne électorale, tendant à autoriser le Président à négocier avec le Danemark un accord en vue de l’achat du Groenland. Si le gouvernement danois n’entend pas céder le territoire, il pourrait négocier des accords économiques et militaires relatifs au territoire.
2 – Le Président Trump a aussi proclamé vouloir reprendre le canal de Panama « in full, quickly and without question ». Il s’agit d’une des plus importantes voies navigables pour le commerce mondial, qui relie l’Atlantique au Pacifique, en passant par la mer des Caraïbes. Pour le Président élu des États-Unis, l’abandon du canal au Panama en 1999 fut une « terrible erreur », imputable au Président Jimmy Carter qui l’a vendu ou même donné. Il est vrai que la création et l’histoire de cet État d’Amérique centrale sont intimement liées au percement du canal et à la politique traditionnelle des États-Unis dans la région.
L’isthme de Panama relevait de la souveraineté territoriale de la Colombie. L’idée de la construction d’un canal remonte à Charles Quint en 1534. Elle est reprise en 1850 et consacrée par le traité Clayton-Bulwer du 19 avril entre les États-Unis et l’Angleterre qui entendait se réserver des droits sur la future voie d’eau. À l’origine, la Colombie accorda en 1882 un permis de construire à une société française fondée par Ferdinand de Lesseps, auteur du percement du canal de Suez. Après sept ans de travaux, la compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, insuffisamment financée, sombre par l’effet des complications du chantier et du scandale financier qui aboutit à sa liquidation. Le renoncement de l’Angleterre au projet en 1901 (traité Hay-Pauncefote) consacre le droit des États-Unis d’administrer, de gérer et de défendre le futur canal sous réserve de la liberté de passage des navires étrangers. La crise politique en Colombie conduit le gouvernement américain à engager avec cet État des négociations qui s’enlisent. Un traité Hay-Herràn est négocié avec la Colombie qui accorde aux États-Unis des droits sur un espace territorial le long du canal à venir, mais le Sénat de Colombie refuse de le ratifier. En 1903, à la faveur du soulèvement de la population locale, soutenu par la marine américaine, la République du Panama voit le jour, reconnue aussitôt par les États-Unis qui signent avec le nouvel État le traité Hay-Bunau-Varilla du 18 novembre 1903 sur la construction du canal qui confirme les règles relatives à la navigation formulées avec l’Angleterre en 1901. Il n’est pas indifférent de préciser que Bunau-Varilla, le représentant du Panama, avait négocié sans consentement formel du gouvernement panaméen et qu’il n’avait pas vécu dans son pays depuis dix-sept ans… Surtout, le traité étend les droits des États-Unis en leur offrant le monopole de la construction et de la gestion du canal ainsi que de toutes autres voies de communication à travers l’isthme ; les États-Unis obtiennent à perpétuité l’usage, l’occupation, le contrôle d’une zone de dix milles le long du canal à travers l’isthme sur laquelle ils exercent tous les droits, pouvoirs et autorité qu’ils posséderaient et exerceraient s’ils étaient souverains sur ce territoire, en excluant de tels droits pour la République de Panama. En outre, les États-Unis se voient reconnaître le droit d’assurer la défense militaire du canal et de construire à cette fin toutes les fortifications nécessaires et enfin ils ont le droit d’intervenir militairement pour garantir l’indépendance du Panama. En contrepartie de ce quasi-transfert de souveraineté, les États-Unis s’engageaient à verser 10 millions de dollars et à payer un loyer annuel de 250 000 dollars.
Le canal est ouvert en 1914 mais certains citoyens du Panama s’interrogent sur la validité du traité. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une des plus importantes voies navigables du monde car elle évite aux navires le long voyage et le contournement difficile du continent sud-américain par le Cap Horn. Des travaux d’élargissement importants ont été effectués au début du XXIe siècle pour permettre le passage de navires gigantesques selon les normes « new Panamax » ou Neopanamax qui désignent les dimensions nouvelles des grandes unités.
Toutefois, le dossier a connu des rebondissements. Des tensions entre les deux États se sont fait sentir ; des incidents violents ont opposé en 1964 des résidents américains et des citoyens du Panama au sujet du droit de battre le pavillon du Panama dans la zone du canal. Après une brève interruption, les relations diplomatiques ont été rétablies et il est apparu nécessaire de renégocier l’accord. Cela aboutit à trois traités relatifs au statut du canal en 1967 mais, à la suite de la défaite électorale du Président Marco Robles face à Arnulfo Arias Madrid en 1968, un coup d’État mené par le Colonel Omar Torrijos a renversé celui-là et établi un nouveau gouvernement. L’affaire a rebondi car ce dernier voulait un nouveau traité tout autant que les dirigeants américains lors de la présidence Nixon. Henry Kissinger évoque le dossier avec le Président Ford et une délégation conduite par Ellsworth Bunker négocie et prépare une série de projets. Ces actes constituent la base du nouveau traité conclu sous le Président Jimmy Carter qui avait déclaré pendant la campagne électorale qu’il entendait bien ne pas renoncer au contrôle de fait sur le canal et sa zone à aucun moment. Mais les positions des candidats ont évolué sur la question de savoir s’il fallait ou non un nouveau traité. L’entourage du nouveau Président, Jimmy Carter, l’inclina dans un sens favorable et peu après son élection ce dernier en fit une priorité. Toutefois, en dépit du vœu des deux parties de conclure un nouveau traité, des obstacles existaient. Dans le droit américain, tout traité doit être ratifié par le Sénat à la majorité des deux tiers ; or, plusieurs sénateurs étaient hostiles à la restitution du contrôle de la zone du canal au Panama. Certains dénonçaient le risque d’encerclement des États-Unis, d’autres se méfiaient de Torrijos suspecté d’être communiste. Des contacts diplomatiques furent pris et on poursuivit la négociation dans un psychodrame auquel fut mêlé l’acteur John Wayne ami de Torrijos…Il fut décidé que deux traités seraient soumis au Sénat des États-Unis. Le premier, relatif à la neutralité permanente et au fonctionnement du canal, affirmait que les États-Unis pourraient user de la force militaire pour défendre le canal contre toute menace à sa neutralité, leur garantissant ainsi un usage perpétuel de cette voie navigable. Le second, accord relatif au canal de Panama lui-même, déclarait que la zone du canal de Panama cesserait d’exister le 1er octobre 1979 et que le canal lui-même serait rendu aux Panaméens le 31 décembre 1999. Il fallut six mois au Sénat américain pour voter sur la ratification des deux traités, en mars 1978, assortis d’amendements d’interprétation « déformants » et de réserves, puis plus d’un an pour que le Président Carter signe la législation d’application le 27 septembre 1979. La coopération fut de courte durée car les relations entre les deux États se tendirent à la mort de Torrijos en 1981 ; en 1989, le Président Georges H.W. Bush ordonne l’invasion du Panama pour que soit écarté du pouvoir le général Noriega qui fut alors détenu pour trafic de drogue aux États-Unis et condamné par contumace pour meurtres au Panama. Toutefois, à partir de 2000, comme cela était prévu, le Panama a recouvré l’exercice de la souveraineté sur l’ensemble du territoire, y compris l’usage de ses ports et la propriété du chemin de fer. La gestion du canal lui a été transférée graduellement ; la commission du canal, organisme public américain régi par la loi américaine, a perdu ses prérogatives gouvernementales, administratives et commerciales et elle a été remplacée, en 2000, par une Autorité, créée en vertu de la Constitution du Panama et régie par une loi organique, qui assure l’administration, l’utilisation, la protection et la maintenance du canal. L’exploitation de la voie d’eau doit contribuer au développement économique du Panama et non plus profiter aux investisseurs et utilisateurs américains. Enfin, conformément aux clauses des traités, selon l’article 315 de la Constitution du Panama dont le titre XIV est consacré au canal, celui-ci « constitue un patrimoine inaliénable de la nation panaméenne ; il restera ouvert au transit pacifique et ininterrompu des navires de toutes les nations ».
Pour le Président élu, cette situation est « une injustice » car il est revenu aux Américains de mener à bien la construction du canal et d’assurer sa gestion et sa sécurité pendant un long temps. En somme des droits historiques ont été créés. Or, cette voie navigable est d’un intérêt majeur pour les échanges avec l’Asie et entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. Dans ces conditions, désormais, les tarifs douaniers et les frais de transit imposés aux États-Unis semblent iniques. De plus, le développement des échanges de l’Amérique latine avec la Chine créé un risque d’autant plus sensible que l’ « Empire du Milieu » a étendu son réseau d’accords dans la région : en particulier, le Panama a établi des relations diplomatiques et conclu une série d’accord avec le gouvernement de Pékin dont il a même reconnu la souveraineté sur Taïwan : pour Donald Trump, le canal est passé sous le contrôle de la Chine dont les soldats contrôleraient le canal. Il importe d’ajouter que des entreprises chinoises telles que Landbridge Group et CK Hutchison Holdings, basées à Hong Kong, exploitent des ports aux deux extrémités du canal. Cette présence suscite une certaine inquiétude en raison de la possibilité d’une infrastructure à double usage et d’une manœuvre stratégique du fait des liens de plus en plus étroits entre la Chine et les États de la région. Dans son message de Noël, le Président élu ajoute que si ses réclamations ne sont pas satisfaites, les États-Unis chercheraient à ce que ce bien leur soit restitué, dans son intégralité, sans contestation possible. Il envisagerait même l’emploi de la force armée pour acquérir le canal…Le Président José Raul Mulino a démenti ces allégations ; le ministère chinois des affaires étrangères a contesté les réclamations américaines tout en réaffirmant la neutralité du canal. En revanche, le sénateur Marco Rubio, secrétaire d’État américain pressenti, a vivement critiqué les ambitions de la Chine lors de son audition devant le Sénat le 15 janvier 2025, en dénonçant l’implication de la Chine dans le canal de Panama comme une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.
À ces revendications de principe qui n’ont pas encore été argumentées solidement, s’ajoute la suggestion de Donald Trump de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Il a même évoqué la possibilité de contraindre ce pays par la « force économique ».
3 – Dans un propos lancé à l’emporte-pièce, lors de la visite du Premier ministre du Canada à Mar-a-Lago qui avait pour objet un échange de vues sur l’augmentation de 25% des droits de douane sur les importations du Canada, le Président élu a déclaré : « le Canada n’a qu’à devenir le 51e État américain ». La plaisanterie a fait réagir. Le mot n’était pas dépourvu de sérieux car le Président Trump a regretté que le Canada eût « failli à sa mission à la frontière américaine » en laissant passer un grand nombre de migrants, y compris des clandestins originaires de plus de 70 pays différents. Il a aussi épinglé le déficit commercial des États-Unis avec le Canada, estimé à plus de 100 milliards de dollars. L’« excellente idée » d’intégrer le Canada a été renouvelée quelques jours plus tard en invoquant les économies massives que feraient les Canadiens sur les impôts et la protection militaire. Ces messages ont heurté, d’autant plus que le Canada est entré dans une crise politique illustrée par la démission de la vice-premier ministre, Chrystia Freeland, précisément à la faveur d’un désaccord sur la réponse aux menaces douanières américaines, suivie par celle du Premier ministre Justin Trudeau. En outre, un esprit d’autonomie se fait jour dans certaines provinces canadiennes. Au souverainisme latent du Québec s’ajoute la position singulière de l’Alberta, dirigée par Danielle Smith, province forte de ses ressources pétrolières.
L’idée d’une intégration plus étroite du Canada avec les États-Unis relève de l’intimidation ; elle répond aussi à des intérêts américains précis en matière commerciale, d’immigration et de sécurité, dont l’importance est accentuée par le bilan médiocre de la politique étrangère du Président démocrate sortant. Reprenant la formule du Président Reagan après les revers de la politique étrangère de Jimmy Carter, Donald Trump a promis « la paix par la force » tout en déplorant les « guerres sans fin » lancées ou favorisées par ses prédécesseurs.
Or, le Président élu est conscient des menaces, en particulier de celle que représente le principal adversaire des États-Unis à l’échelle mondiale, la Chine dont la diplomatie en mer de Chine méridionale, dans le Pacifique, et les manœuvres commerciales tentaculaires dénotent une certaine duplicité stratégique et commerciale.
Les initiatives du Président des États-Unis ne sont pas fortuites et révèlent une certaine logique. On peut y voir un renouvellement de la doctrine Monroe ; elles peuvent aussi répondre à l’éveil des impérialismes en Russie, en Chine, en Perse. Alors la République impériale, admirablement analysée par Raymond Aron pour évoquer la place des États-Unis dans le monde entre 1945 et 1972, pourrait connaître une nouvelle fortune.
Jean-Yves de Cara
Professeur émérite Université Sorbonne Cité
Avocat au barreau de Paris, Bremens et associés
Institut Méditerrannéen de Droit et de Géopolitique